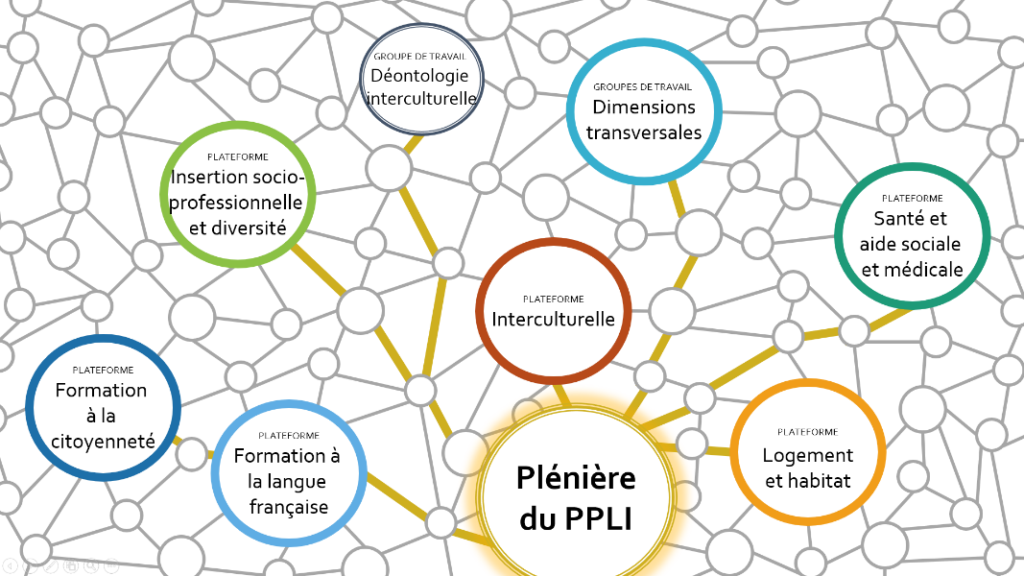La scolarisation des primo-arrivants reste un défi de tous les jours pour les écoles qui accueillent ces jeunes. Le public est hétérogène, souvent peu scolarisé, voire analphabète, et les objectifs pédagogiques, ambitieux, appellent à en faire des élèves ordinaires rapidement. Une gageure, très certainement, dans un système scolaire aussi complexe que le nôtre. C’est compter sans le dévouement des enseignants, de leur direction, pour tenter et parfois réussir l’impossible.

© Image : Flickrcc steve loya
> Voir l’article sur alterechos.be
Rares sont les dispositifs scolaires qui ont connu tant d’évolutions que le Daspa, dispositif qui vise à assurer l’accueil, l’orientation et l’insertion de l’élève primo-arrivant dans l’enseignement. C’est en 2001, sous le nom de « classes-passerelles », que la Fédération Wallonie-Bruxelles s’engage pour la première fois dans la scolarisation des primo-arrivants. Si les motivations sont restées les mêmes, deux décrets sont depuis passés par là. Le dernier date de 2019.
Dans sa dernière mouture, le décret prévoit l’ouverture du dispositif à l’ensemble des écoles avec un financement qui varie en fonction du nombre d’élèves. Le système actuel reflète mieux la réalité des écoles, avec un nombre de 12.118 périodes d’encadrement octroyées et financées cette année contre 6.239 périodes en 2018. Jusqu’alors, cela fonctionnait par appel à projets en fonction de la proximité de centres d’accueil ou de la taille de la ville. L’octroi des moyens était lissé sur la base d’un calcul de moyenne mensuelle sur les deux années scolaires précédentes. Face au nombre d’élèves à scolariser, les écoles pouvaient demander des périodes complémentaires, mais la procédure prenait plusieurs mois entre la demande et l’octroi des périodes complémentaires.
Or, les élèves primo-arrivants sont deux fois plus nombreux qu’il y a dix ans : 968 en Daspa en secondaire en 2010, contre 2.014 en 2020. Pour faire face à la demande, le nombre d’écoles a augmenté ces dernières années, mais, sur le terrain, chaque établissement a dû continuer à travailler avec des classes plus nombreuses, ce qui a influé sur l’encadrement pédagogique et l’apprentissage de ces élèves qui ont besoin d’une aide plus ciblée.
« Ce sont les pauvres qui accueillent les pauvres. Ce sont dans les communes, les écoles, déjà défavorisées que les DASPA se développent. » Julie Dock-Gadisseur, enseignante
« Désormais, tout établissement peut se constituer en Daspa à partir de huit élèves primo-arrivants. C’est un signal positif car cela signifie que tout le monde peut le faire. Une école qui ouvre un dispositif, ouvre son école à l’altérité, c’est très positif, même si cela peut faire peur. Et c’est normal », explique Sandrine Di Tullio, conseillère pédagogique en charge notamment du Daspa au sein du Secrétariat général de l’enseignement catholique. Entre 2018 à 2021, on est passé de 44 à 59 Daspa organisés dans le secondaire, et de 34 à 83 dans le fondamental, avec des besoins plus significatifs en Région de Bruxelles-Capitale, mais également dans les provinces de Liège et de Luxembourg où se situent la majorité des centres d’accueil.
Néanmoins, certains craignent que cette nouvelle donne, dans un contexte où le manque de moyens est prégnant, offre certes aux écoles une source potentielle d’enseignants supplémentaires, mais qui ne serait pas exclusivement dédiée à l’accompagnement des primo-arrivants. Se pose aussi la question de la qualité de l’encadrement. « C’est déjà tellement difficile à gérer avec de l’expérience et de la pratique. Comment faire pour s’adapter à tous ces types d’élèves ou de problématiques quand on n’en a pas ? », s’interroge Julie Dock-Gadisseur, enseignante au Campus Saint-Jean à Molenbeek, un pionnier en la matière. Même interrogation du côté des accompagnants de jeunes primo-arrivants, comme Marie Frenay, du centre d’accueil de la Croix-Rouge pour mineurs étrangers non accompagnés (MENA), situé à Uccle et qui s’occupe d’une septantaine de jeunes. « L’ouverture, plus simple, de classes reste assez théorique. Va-t-on aller trouver l’école du coin, en lui demandant d’organiser un Daspa si le besoin s’en fait ressentir ? Pour le moment, il y a peu de retours en ce sens. Puis, organiser un tel dispositif ne s’improvise pas. On préférera toujours aller dans une école qui organise un Daspa depuis plusieurs années, rodée à l’exercice, plutôt que vers un établissement qui débute avec ce public. »
Par contre, cette nouvelle donne pourrait renforcer la diversité dans les écoles. Actuellement, les élèves primo-arrivants viennent d’abord et avant tout augmenter les effectifs de certaines écoles qui accueillent déjà un public fortement précarisé et stigmatisé. À titre d’exemple, à Bruxelles, ces établissements sont pour la plupart des écoles à discrimination positive, situées dans des quartiers pauvres. « Ce sont les pauvres qui accueillent les pauvres. Ce sont dans les communes et les écoles déjà défavorisées que les Daspa se développent », ajoute Julie Dock-Gadisseur.
Des écoles qui se développent en usant surtout d’une grande imagination pour trouver des solutions adéquates afin de répondre au mieux aux besoins de leurs élèves. S’il existe des conditions communes imposées à tous les établissements, leur marge de manœuvre est assez large. « Cela varie très fort d’une école à une autre, y compris au niveau du programme », constate Marie Frenay.
Sandrine Di Tullio relève aussi ces « réalités variables ». « Celles-ci sont très différentes dès lors qu’on est à Bruxelles ou en Wallonie. Les différences peuvent aussi être importantes en fonction du contexte dans lequel évolue le jeune : en famille, en centre… les besoins ne seront pas les mêmes. C’est un mille-feuille, et ce serait une erreur de parler du Daspa comme d’un tout. Chaque dispositif a ses spécificités, et donc des besoins, et des enseignants dans des situations différentes. »
Le mot d’ordre, c’est la flexibilité
À l’Institut Saint-Laurent à Liège, le Daspa a débuté voilà quatre ans. « À la base, on était un ‘satellite’ d’une autre école située à Verviers. On a commencé avec une classe pour accueillir les élèves qui étaient ‘en trop’ à Verviers afin de désengorger leur Daspa. Cela a été difficile au début : c’était marginal au sein de l’école, il y avait peu de communication… », indique Charles Wauters, coordinateur du Daspa. Le dispositif évolue pourtant rapidement passant d’une classe de 7-8 élèves à 40-50 jeunes. « Aujourd’hui, on a six classes de Daspa, ce qui correspond à 70-80 élèves. »
« On accueille des élèves aux parcours, aux vécus et à la scolarisation très différents. Ce qui rend la tâche particulièrement difficile pour l’enseignant qui ne pourra pas travailler de la même façon avec tous les élèves. » Déborah Meunier, Université de Liège
Face à cette évolution rapide, tout est à inventer en permanence pour le coordinateur et son établissement. « Comment on structure ces élèves, comment on compose la classe, sur la base de quels critères… Cela pose énormément de questions », résume Charles Wauters. Il y a trois ans, l’établissement liégeois a commencé à organiser le dispositif en fonction du niveau de français écrit, ce qui permettait de faire passer un test aux élèves pour les orienter au mieux en fonction de leurs besoins. « On a constitué les groupes sur cette base, en allant des moins avancés vers les plus avancés. On permettait à chaque élève qui progressait bien de passer d’un groupe à un autre, en cours d’année. » Toutefois, après réflexion, l’équipe s’est rendu compte que le dispositif fonctionnait mieux si toute la classe passait ensemble d’un niveau à un autre. « Preuve qu’il n’y a pas de recette toute faite. On continue à chercher. »
La flexibilité est vraiment le mot d’ordre du Daspa, selon le coordinateur. « On doit sans cesse s’adapter, et c’est certainement compliqué : cela demande plus de temps, d’implication qu’un autre type d’enseignement. Mais on n’est pas à plaindre, y compris au niveau financier. » Avec les moyens à sa disposition, l’établissement liégeois a fait le choix de faire des classes un peu plus nombreuses – 12, 13 par classe –, et d’engager une psychologue qui travaille à temps plein. « De la sorte, notre Daspa est piloté par trois personnes : un coordinateur, une éducatrice et une psychologue. Le fait d’être trois permet aussi d’adapter le dispositif aux réalités des jeunes. »
Un public très hétérogène
Les situations des élèves sont diverses. Le Campus Saint-Jean à Molenbeek accueille un public varié en termes d’âge, de langue et d’origine, de niveau scolaire et de motif migratoire. Ces jeunes n’ont jamais été scolarisés, ou très peu, avant leur arrivée en Belgique. Un grand nombre d’entre eux ne parlent pas le français. D’autres ne sont pas alphabétisés dans leur propre langue. « Chez nous, les élèves moins scolarisés représentent 50 % du public. On a 51 élèves cette année, dont 23 jeunes non alphabétisés », indique Julie Dock-Gadisseur.
Ces dernières années, le profil des élèves évolue, avec une explosion du nombre d’adolescents analphabètes. Des jeunes parmi lesquels des Syriens et des Afghans qui ont fui leur pays. « Ce sont des élèves qui n’ont jamais été à l’école dans leur pays, qui n’ont jamais été assis à une table pendant plus de dix minutes, qui ne savent pas se taire en classe, qui n’ont jamais été en contact avec de l’écrit…, poursuit Julie Dock-Gadisseur. Ils doivent tout apprendre dans le domaine scolaire comme un enfant de première maternelle, en étant adolescents, et dans une langue étrangère. Comment peut-on faire cela en un an, même en deux ? » Nombreux sont les pédagogues, éducateurs et enseignants à réclamer depuis longtemps une révision de la temporalité du Daspa. Dans le nouveau décret, la durée en Daspa a été allongée jusqu’à 24 mois pour les élèves non alphabétisés, contre 18 auparavant. À ce jour, 5 à 10 % des élèves inscrits en Daspa ont d’ailleurs été prolongés. Une évolution bienvenue même si elle apparaît encore insuffisante pour les jeunes les moins scolarisés.
« Avec l’immersion, le DASPA n’est plus cette classe fermée sur elle-même. Il devient vraiment un dispositif ouvert, et c’est cela qui déstabilise. » Sandrine Di Tullio, conseillère au SEGEC
Ces jeunes se retrouvent aussi dans une fragilité psychologique, encore trop peu prise en compte après un exil synonyme d’expériences traumatiques. Difficile alors pour ces derniers de s’inscrire dans les apprentissages. « On rencontre en effet pas mal de situations de décrochage scolaire, constate Marie Frenay. Ce n’est pas forcément lié au Daspa en tant que tel. Il y a aussi la réalité du jeune qui est encore souvent en procédure, qui a eu un parcours migratoire traumatique et qui rencontre des difficultés personnelles. »
« Ces jeunes n’arrivent jamais dans de bonnes conditions, d’où qu’ils viennent, renchérit Julie Dock-Gadisseur. Ce sont toujours des situations compliquées, y compris pour des personnes venant de pays plus privilégiés. Majoritairement, les conditions sont loin d’être adéquates pour entamer n’importe quel type de parcours scolaire. Cette réalité, les autorités l’oublient trop souvent, il me semble… C’est pourquoi une aide psychosociale adaptée, formée et présente sur le terrain me semble nécessaire. En tous les cas, nous manquons cruellement de ce type de soutien. »
Du soutien, les enseignants en manquent aussi dans leurs pratiques pédagogiques quotidiennes face à un public aussi hétérogène au niveau tant de ses compétences que de son vécu. Une situation inhérente au Daspa comme le rappelle Déborah Meunier de l’Université de Liège (département de langues et littératures françaises et romanes). « On accueille des élèves aux parcours, aux vécus et à la scolarisation très différents. Ce qui rend la tâche particulièrement difficile pour l’enseignant, qui ne pourra pas travailler de la même façon avec tous les élèves. Les approches méthodologiques seront différentes en fonction du profil des jeunes. C’est un des enjeux majeurs qui impose de former les enseignants à adopter une posture assez éclectique, en les formant à différentes méthodologies, parmi lesquelles ils auront à choisir en fonction des besoins des élèves. Ce qui explique aussi l’absence de référentiels et de programmes pour le Daspa. C’est à la fois une nécessité – je pense qu’il est nécessaire d’avoir une liberté pour pouvoir réagir au mieux en fonction de l’élève et du cadre dans lequel l’enseignant évolue – mais cela peut aussi amener le professeur à se sentir démuni parce qu’il n’a pas de balises. C’est tout le paradoxe du Daspa. »
Tout cela contribue à la fragilité du dispositif. « L’enseignant a à peine eu le temps de construire une expertise qu’il doit en retrouver une autre parce que le public a changé », reconnaît Sandrine Di Tullio. Néanmoins, malgré ces difficultés, les enseignants en Daspa sont souvent présents dans ces dispositifs par choix, parce que cela correspond à des valeurs et à l’envie de participer à un processus sociétal au sein du monde éducatif. « On rencontre des enseignants qui acceptent constamment d’être bousculés dans leurs évidences par ces jeunes qui arrivent de l’autre bout du monde. C’est cela, le quotidien en Daspa. Pour l’enseignant, il s’agit d’accepter de ne rien tenir pour acquis et de se laisser interroger par les besoins de ses élèves », poursuit-elle.
Sortir le Daspa de son ghetto
Le nouveau décret plaide pour une immersion obligatoire de ce public dans les autres classes du système scolaire. Ainsi, après dix mois, l’élève inscrit dans un Daspa participe, pour un minimum de six périodes par semaine, à une classe correspondant à son âge ou à l’année d’étude envisagée pour favoriser son inclusion. « Cela se justifie par ce que les recherches ont montré : laisser trop longtemps un élève dans un dispositif fermé, une ‘bulle’ telle qu’elle avait été pensée au début 2000 avec les classes-passerelles, en laissant les enfants primo-arrivants entre eux dans des classes d’âge mélangées, rend l’inclusion plus difficile. Pour sortir de cette logique de ‘ghetto’, de stigmatisation, il y a eu l’idée d’imposer une immersion progressive le plus tôt possible », rappelle Déborah Meunier.
Le problème est qu’en imposant l’inclusion après 10 mois, on va se retrouver, en secondaire, avec des jeunes analphabètes au milieu d’autres jeunes alphabétisés. « C’est dramatique, continue-t-elle. D’où l’urgence de former les enseignants pour que ces enfants soient accompagnés. Cela dit, une inclusion peut être progressive, pas à temps plein. C’est là où il faut pouvoir jouer avec le décret, en proposant à l’élève de rejoindre la classe ordinaire quelques heures par semaine. Certains jeunes sont très demandeurs. J’ai rencontré des enseignants avec des ados de 16 ans qui réclament de pouvoir être dans une classe avec des jeunes de leur âge. Dans ces situations, l’enseignant essaie de construire un co-enseignement avec un autre enseignant pour permettre à l’élève d’aller quelques heures par mois, par semaine, avec sa classe d’âge, histoire de le motiver. »
« On constate que si la transition entre le DASPA et l’enseignement ordinaire a été faite trop vite, cela peut créer un décalage pour le jeune qui va se sentir rapidement dépassé. » Marie Frenay, Référente MENA à la Croix-Rouge
Sandrine Di Tullio reconnaît l’énorme chantier qu’une telle mesure impose pour former les enseignants, les accompagner, leur donner des moyens en termes de pratiques pédagogiques : « Avec l’immersion, le Daspa n’est plus cette classe fermée sur elle-même. Il devient vraiment un dispositif ouvert, et c’est cela qui déstabilise. On est au début de quelque chose : désormais, le travail sera aussi d’accompagner les enseignants du Daspa à accompagner les jeunes à en sortir, puisque, dès l’entrée, on envisage la sortie… »
En attendant la révolution, il faudra se contenter de la réalité. Et celle-ci reste problématique, car l’immersion dans le système scolaire ordinaire se résume encore trop souvent à des orientations pour la plupart inadéquates en enseignement professionnel ou spécialisé.
Actuellement, après le Daspa, environ 40 % vont en secondaire général, 45 % en professionnel et 15 % en technique. « Ils sont redirigés dans des options soit où il y a de la place, soit qui correspondent plus ou moins à ce qu’ils veulent faire. Mais cela peut aussi les frustrer parce qu’ils se retrouvent dans des classes plus nombreuses, des classes où il y a moins de soutien… On constate que, si la transition entre le Daspa et l’enseignement ordinaire a été faite trop vite, cela peut créer un décalage pour le jeune qui va se sentir rapidement dépassé », souligne Marie Frenay.
Si les options ne correspondent pas toujours, les écoles se retrouvent aussi dans une incapacité à accompagner sur le long terme les élèves les plus fragiles, à savoir les non-scolarisés et non-alphabétisés. « Cet après-Daspa est inexistant pour ce public-là. Il n’existe pour l’instant pas de classes à un niveau accessible pour ce type d’élèves. Ils se retrouvent dans l’enseignement différencié, qui vise à préparer le certificat d’études de base, mais ces jeunes analphabètes n’en sont pas encore capables. C’est là le problème majeur du dispositif. Ces classes différenciées ne sont pas adaptées à leur niveau. C’est un parcours d’échec cuisant qui s’amorce dès la sortie du Daspa. Ils sont perdus, les profs ne savent pas quoi en faire… », déplore Julie Dock-Gadisseur.
Là aussi, chaque école tente de s’adapter pour favoriser la meilleure transition possible, sans avoir attendu le décret. « Ce passage entre le Daspa et une classe ‘traditionnelle’ est un travail de confiance à réaliser avec le corps enseignant, ajoute Charles Wauters. Quand le dispositif a débarqué dans notre établissement, il y avait une méfiance. Certains ont craint un ‘nivellement’ par le bas. Quand ils ont vu un Daspa et ont compris que cela impliquait d’accueillir des élèves extrêmement fragiles sur le plan de la langue, ils se sont dit que l’école allait droit dans le mur. La crainte de certains collègues était parfaitement compréhensible : les défis propres à l’enseignement technique et professionnel sont bien assez nombreux, l’équilibre de ces classes est déjà fort précaire. Il a vraiment fallu les rassurer sur le fait que leur travail n’allait pas forcément devenir plus difficile. Une des clés consiste à bien connaître l’école pour savoir dans quelles classes, dans quelles sections, nos élèves ‘Daspa’ ont le plus de chance de s’intégrer harmonieusement. »
Pour créer ce climat de confiance, tout l’enjeu est désormais d’accompagner tous les enseignants de classe ordinaire sur l’accueil de ces élèves au-delà du Daspa. « Ils ont des craintes parce qu’ils ne savent pas comment s’y prendre. C’est très légitime parce que la formation initiale des enseignants ne prévoit pas cela. Ils sont formés sur la base d’un public ‘locuteurs natifs francophones’ », rappelle Sandrine Di Tullio. De par son existence, le Daspa laisse à penser aux autres enseignants qu’ils ne sont pas concernés par cette problématique, que c’est aux enseignants du Daspa de faire en sorte que les élèves parlent français. « Aussi, quand ils arrivent dans une classe ordinaire, ils devraient être comme des francophones, alors que le travail continue après le Daspa. Mais un prof de maths ou de sciences est aussi un prof de langue, prof de la langue de sa discipline… D’où tout l’intérêt de décloisonner le dispositif pour que la coupure soit moins nette », termine Sandrine Di Tullio. De son côté, la Fédération Wallonie-Bruxelles travaille actuellement sur la construction d’un indicateur permettant de suivre le parcours scolaire de ces élèves, avec une première évaluation du décret qui aura lieu au cours de l’année scolaire 2022-2023.