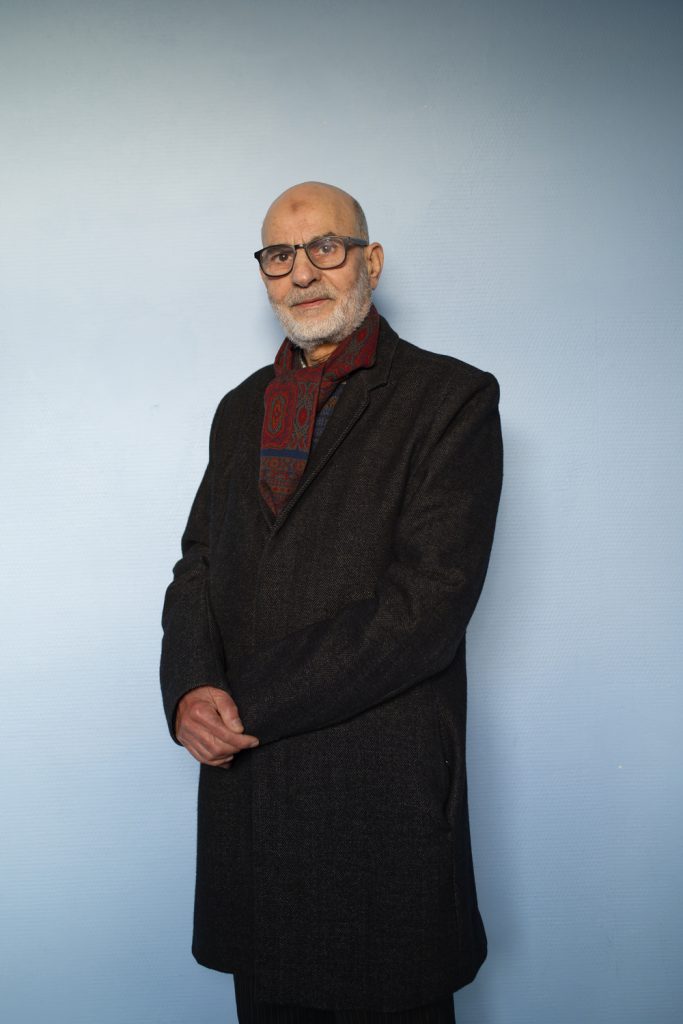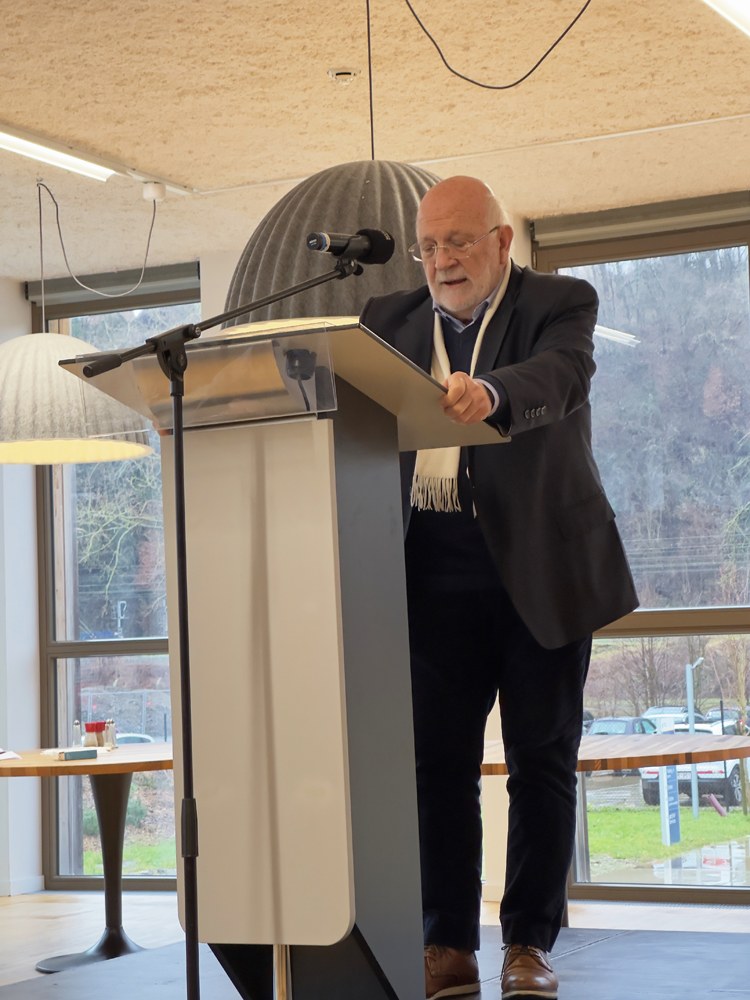Photo 4 : Anil Keçeliöz
Anil KEÇELIÖZ
“Nous vivons ici, donc nous devons connaître le mode de vie d’ici,
mais il ne faut pas oublier ses origines.”
Centre d’action interculturelle, 3 décembre 2024, Namur.
Témoignage :
Je m’appelle Anil Keçeliöz. J’ai quarante-quatre ans. Je vis depuis trois ans à Jemeppe-sur-Sambre. Je suis originaire de Çorum, à environ deux cents kilomètres d’Ankara. Je n’ai pas du tout le même parcours que la plupart des immigrés turcs. J’ai vécu très longtemps dans ma ville natale avec toute ma famille et mes amis. Pendant dix-neuf ans, j’ai enseigné l’anglais en Turquie.
En 2014, avec deux amis d’enfance, nous avons postulé pour enseigner le turc en Europe. Nos candidatures ont été retenues par le ministère de l’Éducation turc. Mon meilleur ami et moi nous avons été désignés pour enseigner en Belgique. Les cours étaient donnés après l’école à des enfants d’origine turque. Ils avaient des niveaux de connaissance de la langue très variables.
La première image de la Belgique que j’ai eue, c’est la rue de Mons à Marchienne-au-Pont ! Ma vision carte postale de l’Europe s’est heurtée à la réalité. Mais depuis j’ai appris à mieux connaître ce pays.
Ce qui est différent ici, c’est que la socialisation ne se fait pas uniquement au sein de la famille restreinte, les gens côtoient beaucoup d’autres personnes, ils ont beaucoup de loisirs. En Turquie, les gens n’ont pas beaucoup de hobbies, ils ont moins de loisirs et d’activités. On reste dans la sphère familiale ou on va boire un café dans un bar.
Les programmes scolaires mettent l’accent sur les sciences, les mathématiques, la physique, la géographie, l’histoire. Tout est basé sur les examens, la réussite. En Belgique, on apprend plus de choses aux enfants, comme faire la soupe par exemple (sourire).
Par contre en Turquie, quand on a un problème à la maison, il y a tout de suite une solution. Tu appelles le plombier, il arrive immédiatement. Il y a toujours des spécialistes disponibles dans tous les domaines. Les Belges sont plus bricoleurs, ils essaient de réparer eux-mêmes. Je les admire, ils sont manuels, ils se débrouillent. Ils peuvent passer trois heures dans leur jardin, alors qu’en Turquie, on paye un jardinier. C’est pour ça qu’on dit souvent : “Türkiye’de Yok Yok” (“En Turquie, il n’y a rien qu’il n’y ait pas”).
Alors que mon cœur était resté chez moi avec les miens, j’ai rencontré Caroline, qui terminait des études de médecine. Je l’ai épousée en 2019 à Marcinelle. Quand mon contrat de travail turc a pris fin, nous sommes partis nous installer durablement à Fethiye, en bord de Méditerranée. Ma femme aimait beaucoup la vie en Turquie, mais les conditions de travail étaient difficiles pour elle. En 2022, nous avons décidé de rentrer en Belgique pour de bon. Nous comptons y rester jusqu’à la pension et ensuite nous rêvons de passer six mois par an dans chacun de nos deux pays, et d’acheter une maison près de la mer.
Ma famille aime beaucoup Caroline. Et moi, je suis bien dans ma belle-famille : ils s’intéressent à mon pays et à sa culture. Ils ont visité la Cappadoce, Pamukkale… Il y a un grand respect mutuel. Je suis en quelque sorte marié avec les deux pays, je suis un peu l’interprète entre les deux cultures. Il fallait faire un choix, et nous avons opté pour la Belgique. Les Wallons sont chaleureux, mais la vie n’est pas du tout la même qu’en Turquie. Quand ma femme explique qu’elle est mariée à un Turc, les gens sont persuadés que je me suis marié pour les papiers. Alors elle leur répond que nous sommes ensemble depuis des années. C’est un stéréotype courant le mariage blanc, alors que moi j’avais un travail là-bas, des amis, une vie tranquille auprès des miens.
Quand les touristes vont en Turquie ils se rendent compte que les Turcs de là-bas vivent différemment de ceux qui sont en Belgique. Certains pensent qu’on y parle l’arabe ou que les femmes ne peuvent pas conduire.
Actuellement, je suis en recherche d’emploi. J’ai essayé d’obtenir une seconde mission en tant que professeur de turc mais le Covid-19 a tout chamboulé. Alors pour l’instant je travaille mon français. Il faut dire que ma femme et moi, nous parlons anglais entre nous. C’est difficile de trouver sa place quand on ne travaille pas. Au bureau on passe beaucoup de temps avec ses collègues, on fait des connaissances… Je suis quelqu’un de casanier, ça ne facilite pas les choses.
Il faut s’intégrer, bien sûr. Mais qui doit s’intégrer ? Qui intègre ? Est-ce que c’est le jeune Turc qui doit s’intégrer ou la société qui doit l’accepter ? Il y a une différence entre intégration et assimilation. Nous vivons ici, donc nous devons connaître le mode de vie d’ici, mais il ne faut pas oublier ses origines. Les oublier, c’est de l’assimilation. À l’inverse, quand par exemple il y a une activité organisée dans le milieu scolaire, les parents turcs n’y participent presque jamais. La non-participation à la vie sociale favorise le repli communautaire. C’est valable dans les deux sens.
La nouvelle génération est née en Belgique, ils ne connaissent pas ou très mal leur pays d’origine. Ils parlent souvent le turc à la maison ou l’apprennent en regardant des séries télévisées. Mais ils ne savent pas toujours que la Turquie est multiculturelle, que des personnes de cultures différentes y cohabitent. Le fait d’être né dans un pays et d’avoir des origines différentes renforce l’appartenance communautaire, ce qui est normal. Mais il ne faut pas oublier que les sociétés évoluent et que la nouvelle génération vivant en Turquie se modernise.

L’ensemble des photos et témoignages sont également repris dans l’ouvrage « Accords au présent », édité chez Couleur Livres.